Ce^petit texte me semble très éclairant, à l'heure où le sommet de Copenhague s'ouvre :
« Du point de vue de leur attitude face à la nature, les Français se sont longtemps comportés comme des Méditerranéens, héritiers des conceptions judéo-chrétiennes , et plus largement méditerranéennes, selon lesquelles l’homme est le couronnement d’une création à laquelle il commande. La vision animiste, d’origine celtique et germanique, d’une nature sacralisée qui doit être crainte et respectée, n’a survécu que dans certains rites religieux tolérés et récupérés par le christianisme. (…)
Avec les Lumières, les conceptions de l’Europe réformée gagnent la France. Jean-Jacques Rousseau vante les beautés de la nature laissée en dehors du vouloir humain. L’élite découvre les plaisirs de gravir les montagnes escarpées, en frissonnant de plaisir devant le danger. (..) de là naît le tourisme fondé sur le dépassement et la contemplation. (…) C’est dans cette métaphore paysagère de la fin d’un monde que prend racine le sentiment aujourd’hui très répandu, d’un « contrat » à passer entre une « humanité » profiteuse et irréfléchie et une « nature » bonne, fragile et menacée (Michel Serres). »
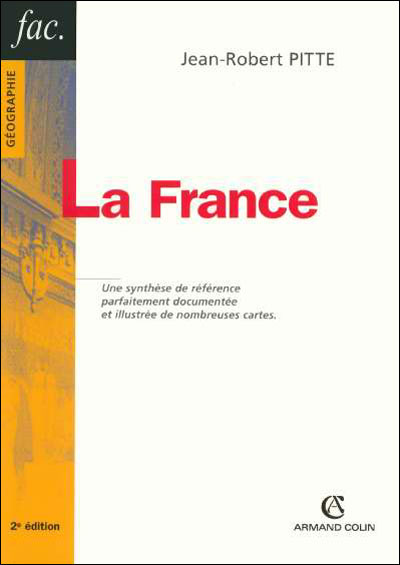
In La France, J.-R. Pitte, Armand Colin, 1997 et 2007, pp. 55 et 56
Il y a bien là deux conceptions du rapport à la nature : celle qu'il faut dompter, celle qu'il faut respecter. On peut trouver là un exemple de géopsychologie que je développerai un jour.
Deux attitudes qui me paraissent désormais universelles, et qui traversent les clivages politiques habituels. Deux attitudes qui ont leur propre justification et légitimité. Deux attitudes qu'il faut, probablement, conjuguer pour éviter les excès de cris d'orfraie des uns, les excès de confiance technicienne des autres.
O. Kempf
1 De DanielB -
Bonjour ,
le Chimiste Russe Dmitri Mendeleiev developpait aussi l'idée que les ressources naturelles de la Russie n'étaient pas faites pour être " admirées comme des vaches sacrées " mais pour être exploitées
http://zebrastationpolaire.over-blo... père du petrostatisme russe et des expéditions arctiques .-24128535.html
1- Dans l'intérêt des Russes et de la Russie ( charité bien ordonnée commence par soi même ! )
2- Dans l'intérêt du " genre humain "
" Du point de vue de leur attitude face à la nature, les Français se sont longtemps comportés comme des Méditerranéens, héritiers des conceptions judéo-chrétiennes , et plus largement méditerranéennes, selon lesquelles l’homme est le couronnement d’une création à laquelle il commande "
C'était aussi sa position et peut-être " l'excès de confiance technicienne " des Soviétiques .
Avant leur virage " écologiste " , il y a cinq ou six ans , c'était aussi la position officielle de la conférence des évêques Brésiliens à propos de l'Amazonie : Elle est là , don de Dieu , pour permettre aux peuples de la région , et en seconde partie à l' " humanité " , de pouvoir tirer l'usufruit de ses produits .
http://www.cnbb.org.br/ns/modules/m...!_Amaz%F4nia_que_queremos!
La question a aussi divisé le clergé Norvégien à propos des forages dans l'arctique .
http://www.climateark.org/shared/re...
Cordialement
Daniel BESSON