Chantre rappelle tout d'abord que tout le travail de Girard vient de la littérature et de son analyse du sentiment amoureux (je n'ai plus le titre de la première oeuvre de Girard en tête). Or, celle-ci est à la source du futur désir mimétique car il est d'abord question de désir, et de désir de quelque chose qui n'est pas forcément l'autre, mais un objet (ou plus exactement, on désire tous les deux le même objet ce qui provoque la rivalité). Il y a ainsi une déviation du désir, ce qui provoque tous les quiproquos, les envies, les triangulations passionnelles classiques de la llittérature. Le plus important pour Girard n'est alors pas ces échaffaudages mais la question du désir. Le désir est à la source de la rivalité, là est le point le plus significatif. Car du coup, c'est la rivalité qui devient centrale, bien plus que son expresion. La rivlaité est source de la violence (d'où le deuxième livre, La violence et le sacré).
Mais cette rivalité est interpersonnelle, interindividuelle. Cela étant, Girard explique que cette rivalité peut s'élever au niveau de la foule, d'où sa théorie du bouc émissaire. On passe alors de l'un au multiple. A l'intérieur, toutefois, d'un cadre donné, celui d'une société constituée.
Or, la géopolitique est classiquement l'étude de la rivalité des puissances sur des territoires. J'ai toujours été frappé par la négligence des géopolitologues envers cette question de la rivalité. Elle est pour moi centrale et explique pourquoi la géopolitique n'est pas simplement affaire de géographes, mais aussi de strtaégistes : si j'avais à contribuer à al théorie géopolitique, ce serait el thème de mes recherches. Le stratégiste, en efet, analyse forcément la conflictualité. Il a conscience de la rivalité intrinsèque entre armées. Le conflit est justement un moyen de résoudre cette rivalité. Alors que le bouc émissaire permet à la commuanuté de se défouler (aux deux sens du terme, comme le remarque habilement Chantre dans l'émission de ce soir : non seulement expulser le surcroît de pression passionnelle mais aussi quitter le mécanisme de foule qui porte à l'ascension aux extrêmes), la guerre permet aux deux rivaux collectifs d'expulser leur rivalité.
La guerre devient ainsi une pulsion qui extériorise, entre deux commuanutés et non plus à l'intérieur de l'une, une rivalité qui s'exprime.
Une limite toutefois : la cause de la rivalité est chez Girard le désir. Or, on distingue classiquement trois causes de guerre : les ressources, l'honneur et la peur. La rivalité est évidente pour la première cause, mitigée pour la seconde, peu évidente pour la troisième. Il reste que la rivalité peut expliquer à la fois les guerres civiles et les guerres extérieures. Elle n'explique pas tout de ces guerres mais si elle permet d'en expliquer par un facteur commun une partie des deux, voici déjà un progrès. C'étiat la découverte de la soirée...
O. Kempf
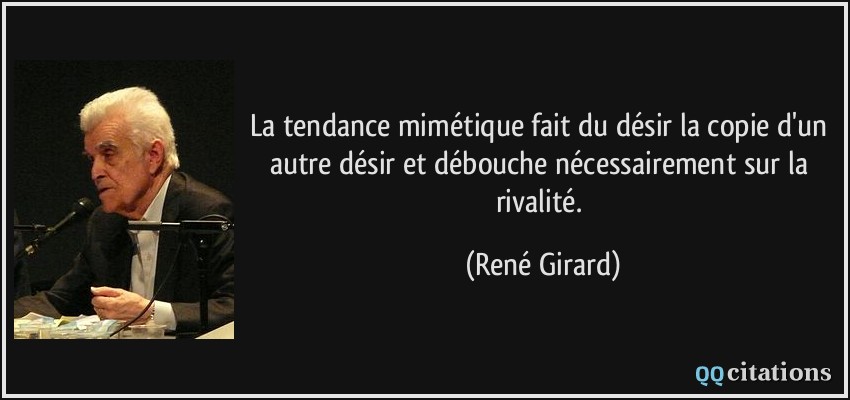
1 De Leon -
"La rivalité est évidente pour la première cause, mitigée pour la seconde, peu évidente pour la troisième."
Pour la peur: sans extrapoler trop loin, ne peut-on pas trouver une rivalité pour la securité ou pour le sentiment de securité ? L'idée serait alors une interpretation (ou 2 interpretations similaires et concurrentes)de la seule presence ou des actes de l'autre comme d'un obstacle a ma securité - ou mon sentiment de securité. Si cette menace est percue comme insupportable, la peur provoque la guerre par competition pour la securité.
too complicated ?
2 De Pierre AGERON -
Bonsoir
Merci de nous remettre en tête cette émission.
Pour le lien entre peur (cause de la guerre) et désir , il me semble pas si obscur : Qu'est-ce que la peur sinon le désir de "perserver dans son être", le conatus spinozien! La peur est un levier voire LE levier de réveil du désir de survie, qui engendre la rivalité (ultime ?) entre entre deux volontés antagonistes...
Bien cdlmt
PS Je me rends compte que ce paragraphe peut rappeler un peu trop Spengler dont je n'ai jamais vraiment compris les théories. On pourrait aussi rapprocher le désir du conatus spinozien de l' analyse d"Elias Canetti dans "Masse et puissance", l'un à l'échelle de l'individu, l'autre à l'échelle de la foule . A débattre