Le débat public contemporain évoque la frontière de deux façons : soit en constatant leur « disparition », soit en rappelant le principe de leur « intangibilité ». Pourtant, des événements récents viennent contredire cette perception commune : dispute sino-japonaise sur les îles Senkaku ou sino-vietnamienne sur les îles Spratleys, persistance d’un différend indo-pakistanais autour du Cachemire, construction d’un mur séparant Israël et la Cisjordanie, dispositif européen Frontex, rattachement de la Crimée à la Russie … Autant d’exemples qui nous disent que la frontière n’est pas aussi apaisée que nous en avons le sentiment en passant, sans nous apercevoir, de France à Allemagne ou Belgique grâce à l’autoroute ou au Thalys. Au fond, la frontière serait un attribut encore un peu barbare dont on s’étonne qu’il puisse encore susciter des frictions.
Pourtant, force est de constater que ces frontières sont de plus en plus contentieuses. En Grande-Bretagne, les partis politiques disputent farouchement de la nécessité de renforcer les contrôles aux frontières. L’Italie constate la multiplication des drames de l’immigration illégale au large de ses côtes. Des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants meurent chaque année en voulant gagner l’Europe ou les États-Unis. Enfin, une des plus graves crises de l’espace européen depuis quinze ans se déroule au sujet de frontières changeantes, aux confins de l’Ukraine et de la Russie où les armes parlent. Autant dire que la frontière n’est pas cet objet aussi apaisé que nous le croyons. La frontière redevient de plus en plus l’enjeu de contentieux, parfois armés. Les rapports de la frontière et de la guerre n’appartiennent pas qu’au passé, en Europe comme dans le vaste monde : il est probable qu’il en soit de plus en plus question, dans un avenir prévisible dont il faut dire quelques mots.
Chacun connaît, depuis Clausewitz, les rapports de la guerre et de la politique. Chacun voit bien que la frontière est un objet structurellement politique. Aussi ne sera-t-on pas surpris que cette étude sur les rapports entre la guerre et la frontière emprunte, régulièrement, à l’analyse politique et géopolitique, autour de notions comme celle de l’État, de la souveraineté ou du monopole de la violence. De même, l’indication temporelle « demain » a l’avantage d’être dynamique et de nous pousser à envisager l’avenir. Toutefois, le lecteur ne sera pas surpris si cette étude se réfère à l’histoire : tout d’abord pour observer les continuités (il y en a) mais surtout pour tenter de saisir les discontinuités. C’est ce rapport entre ce qui demeure et ce qui est déjà en train de changer qui nous permettra, je l’espère, de ne pas trop nous tromper dans l’ébauche de l’avenir. Pour cela, nous proposons une articulation en trois temps, exposant tout d’abord les rapports classiques de la guerre et de la frontière, constatant ensuite qu’aujourd’hui la guerre augmente quand la frontière faiblit, ce qui conduit à envisager un chaos prévisible qui devrait bousculer certaines frontières existantes.
I Les rapports classiques de la guerre et de la frontière
A/ Frontières linéaires et non linéaires
B/ Souveraineté, enveloppe et guerre civile
C/ Voulant geler la guerre, on a gelé les frontières
II La guerre augmente quand la frontière faiblit
A/ La transformation récente de la guerre
B/ Simultanément, l’État s’affaiblit
C/ Nouvelles Dynamiques
III Un chaos prévisible qui devrait bousculer les frontières
A/ Un chaos qui s’étend
B/ Un équilibre instable
C/ Comment réinventer le politique ?
Conclusion
La coexistence de trois modes politiques (pré-westphalisme, westphalisme et post-westphalisme) entraîne des rapports différents à l’organisation du territoire et aux rapports entre entités politiques constituées. Partant, la guerre comme mode d’action et la frontière comme expression de ce mode politique sont soumises à des tendances différentes selon les grandes régions.
Dans certaines zones, on peut prévoir une « extension du domaine de la guerre ». Surtout, la plus grande faiblesse d’un ordre mondial organisé et maîtrisé par l’Occident entraîne en fait une compétition des visions de l’ordre mondial (Kissinger). Enfin, la contiguïté de ces zones soumises à des régimes différents suscite une friction générale le long de ces lignes de contention qu’on pourrait dé »signer par « méga-frontières ».
On le comprend, ce rapport tumultueux entre la guerre et la frontière n’est pas près de s’éteindre. Il s’agit désormais de réfléchir à de nouveaux schémas :
Quelle régulation politique organiser ? L’élection au suffrage universel, symbole de la démocratie, constituerait-elle la bonne formule universellement adaptée ? Comment concilier des droits individuels et des droits collectifs qui seraient porteur du « bien commun » ? Comment concevoir un régime universel qui ne soit pas une « occidentalisation » du monde et qui donc relativise le message et les valeurs occidentales ? Un régime universel qui ne soit pas unifiant et qui prennent en compte les disparités ?
Simultanément, comment concevoir des frontières poreuses, non-linéaires, adaptées au nomadisme et aux mouvements de population tels que nous les observons aujourd’hui ? Peut-on envisager des appartenances politiques multiples ?
Autant de questions qui semblent nécessaires et productrices d’ordre politique : la pensée politique constitue alors un moyen de prévention des conflits et des guerres qui s’annoncent.
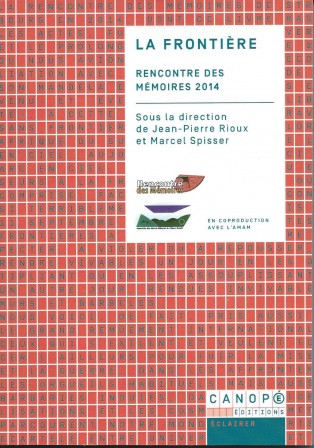
1 De Yves Cadiou -